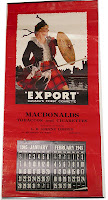Puis, durant le reste de la semaine, comparaîtront messieurs Poirier et Howie, dont le témoignage concerne le comportement de JTI-Macdonald ou de RJR-Macdonald.
Adieu monsieur Gage
Vendredi dernier, le témoignage de Peter Gage a pris fin. L'ancien cadre de Macdonald, puis d'Imperial, puis du CTMC, était interrogé à Victoria, en Colombie-Britannique, et l'interrogatoire était retransmis en direct au palais de justice de Montréal. Jeudi, il avait comparu vêtu d'un veston bleu marine arborant les armoiries du corps des sous-mariniers de la Royal Navy. Vendredi, il était de retour avec un veston civil et les bretelles jaunes citron de mardi, qui ont cette fois inspiré une remarque taquine de la part du juge Riordan.
D'ordinaire, les témoins font face au juge et le public de la salle d'audition ne voit guère leur expression faciale. Avec le visage et le tronc du témoin sur des grands écrans, le public voit ce que le juge voit.
Encore plus, si c'est possible, que lors des deux journées précédentes, M. Gage a témoigné d'un certain état d'esprit dans l'industrie : l'ignorance volontaire. Plusieurs fois, Peter Gage a répété qu'il s'occupait de la production des cigarettes et que cela l'avait maintenu très occupé.
À un moment donné, le procureur des recours collectifs Bruce Johnston a mis sous les yeux du témoin le procès-verbal d'une réunion en 1975 à Imperial Tobacco, qui portait spécifiquement sur les questions de santé relatives à l'usage du tabac, et à laquelle M. Gage participait.
Il y avait régulièrement des réunions sur ce sujet et Me Johnston a demandé si le témoin Gage s'en souvenait.
Il ne s'en souvenait pas. Mais pas parce que cela fait 37 ans. Après tout, le témoin avait des souvenirs très clairs d'événements survenus dans les années 1950. Voici plutôt la raison: « Ce n'était pas ma responsabilité. Je coupais le contact » (It was not my responsability. I put the switch off.), dans ce genre de réunions. Le tout a été dit d'un ton neutre qui n'avait l'air ni d'une justification, ni d'un regret.
Il serait exagéré de dire que le témoin a trahi à un moment ou à un autre une émotion qu'on pourrait croire inspirée par un remords, mais il y a eu quelques moments, comme celui-là, où le nonagénaire Gage, autrement presque aussi à l'aise et gaillard avec Me Johnston qu'avec Me Mitchell, se tenait le front sur le bras droit.
Les avocats Johnston, pour les recours collectifs, et Mitchell, pour la défense de JTI-Macdonald, ont profité de la comparution de M. Gage pour faire verser comme pièces au dossier de la preuve quelques documents, non sans que cela donne parfois lieu à des objections de la partie adverse quant à la pertinence de tel ou tel document. Mais on a déjà vu plus orageux. Le juge Riordan a affublé certains documents d'un R, ce qui veut dire qu'il réserve son jugement et qu'ils ne seront peut-être jamais admis en preuve, donc rendus publics.
Le représentant du gouvernement fédéral canadien, Me Maurice Régnier, n'a pas contre-interrogé le témoin, même si la relecture du témoignage de mardi laisse l'impression générale que la défense faisait comparaître Peter Gage moins pour contrer la preuve des recours collectifs que pour incriminer le gouvernement d'Ottawa, par des allusions à des missions à l'étranger de promotion des exportations canadiennes de cigarettes.
Toutefois, quand Me Simon Potter a témoigné de ce que son père recevait des cigarettes gratuites du gouvernement canadien durant son passage dans la marine lors de la guerre de 1939-45 et a voulu faire témoigner l'ancien combattant Gage de l'existence d'avantages similaires du côté de la Grande-Bretagne, Me Régnier est intervenu pour signaler que tout cela était hors de la période couverte par la réclamation des victimes du tabac aux cigarettiers, laquelle s'étend de 1950 à 1998.
Au secours de la recherche
Dans la matinée de vendredi, comme dans celle de jeudi, Me Gabrielle Gagné, pour le compte des recours collectifs, a fait verser dans le dossier de la preuve au procès une série de documents qui présentent de l'intérêt mais dont le tribunal ne pourra jamais entendre l'auteur, le destinataire, ou une personne dont les propos ou les actes seraient rapportés dans le document.
Dans le lot, il y avait une déclaration faite à la Conférence canadienne sur le tabac et la santé de novembre 1963 par John Keith, président d'Imperial Tobacco Company of Canada Limited (ITCL) et par Léo Laporte, vice-président chargé de la recherche et de la mise au point chez ITCL. (pièce 551 C) À la trentaine de pages de texte de ces deux allocutions à la conférence (organisée par le ministère fédéral de la Santé) était annexée une soixantaine de pages de « points de vue scientifiques » allant dans le même sens, soit d'attribuer la hausse de la prévalence du cancer à un meilleur dépistage, de montrer que la relation de causalité entre l'usage du tabac et le cancer du poumon ou les maladies cardio-vasculaires était incertaine, et de faire douter de tout.
Tout cela dit et écrit au nom d'un comité spécial des quatre grand cigarettiers canadiens, en anglais et en français.
Dans un mémoire d'une quarantaine de pages présenté en mai 1963 à l'Association médicale canadienne (pièce 549), Imperial, toujours au nom des quatre grands cigarettiers, s'inquiétait des conséquences pour la recherche médicale sur le cancer du poumon d'une future possible conviction du public que la cause de ce cancer est toute trouvée.
* **
Pour
accéder aux jugements, aux pièces au dossier de la preuve ou à d'autres documents
relatifs au procès en recours collectif contre les trois grands
cigarettiers, il faut commencer par
1) aller sur le site de la partie demanderesse
https://tobacco.asp.visard.ca/main.htm
https://tobacco.asp.visard.ca/main.htm
2) puis cliquer sur la barre bleue Accès direct à l'information,
3) et revenir dans le blogue et cliquer sur les hyperliens à volonté.
Il y a aussi un moteur de recherche qui permet d'entrer un mot-clef ou un nombre-clef et d'aboutir à un document ou à une sélection de documents
Il y a aussi un moteur de recherche qui permet d'entrer un mot-clef ou un nombre-clef et d'aboutir à un document ou à une sélection de documents